A) L'exécution de mouvements volontaires
1) Qu'est-ce-que le cerveau?
Il existe différents types de mouvements pouvant être classés en deux grandes catégories; certains ne sont pas contrôlés, ils se réalisent de manière inconsciente, on les appelle des mouvements réflexes. Ils ne font pas intervenir le cerveau mais seulement la moelle épinière. Néanmoins, la plupart des mouvements sont décidés, on les appelle volontaires . La décision et la mise en place de ces mouvements proviennent du cerveau.
Le cerveau peut être considéré comme l'organe le plus important du corps humain. Protégé à l'intérieur des os du crâne, il est le centre de commandement du système nerveux. Il a donc le contrôle de tous les organes de l'organisme, notamment des fonctions motrices. Il est composé de cellules cérébrales, les neurones, qui reçoivent et transmettent les informations.
Le cerveau constitue le système nerveux central, lieu de traitement de l'information ; c'est du système nerveux central que partent les commandes motrices vers les organes effecteurs : muscles et glandes, qui permettent la réaction de l'organisme à un stimulus.
Il est constitué de matière grise ou cortex, à la superficie, contenant les corps cellulaires des neurones et de la substance blanche à l’intérieur qui sert de lien entre les différents zones du cerveau et contient les axones des neurones. Ces dernières, aussi appelées fibres nerveuses, constituent le prolongement du neurone qui conduit le signal électrique du corps cellulaire vers les zones synaptiques (zone de contact qui s'établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une autre cellule).
2) La théorie sur l'exécution d'un mouvement volontaire

Les mouvements volontaires sont contrôlées par le cortex moteur, situé vers la partie postérieure du lobe frontal. Il est divisé en plusieures aires: le cortex moteur primaire qui commande les exécutions des mouvements et le secondaire qui planifie et organise les mouvements.
L'exécution d’un mouvement a pour origine un stimulus; "variation d'un paramètre physico-chimique du milieu extérieur ou intérieur susceptible d'être détecté par un récepteur sensoriel spécialisé".
La première étape dans la réalisation d’un mouvement est l’intégration des données sensorielles pour décider le choix du mouvement le plus appropié. L’intention du mouvement se fait au niveau du lobe pariétal ou se situent les aires sensorielles.
L’information est ensuite transmise au cortex moteur secondaire qui se charge de la planification du mouvement, en décidant les types de mouvements nécessaires pour réaliser l’action. Le cortex moteur secondaire se divise en deux parties; l’aire pré-motrice (APM) qui contribue à guider les mouvements en intégrant les informations sensorielles et s’occupe des muscles qui sont les plus proches de l’axe du corps. L' aire motrice supplémentaire (AMS) est elle impliquée dans la planification de mouvements complexes et dans la coordination de mouvements impliquant les deux mains.

Le cerveau est formé de deux hémisphères, divisés à leur tour en quatre parties appelées lobes, nommés d’après les os crâniens qui sont les plus proches, ainsi que le cervelet, situé dans la partie postérieure du cerveau. On compte quatre lobes externes et deux lobes internes. Parmi les lobes externes figurent le lobe frontal, responsable de la coordination motrice volontaire, le lobe temporal qui traite l'ouïe et l'odorat, le lobe pariétal qui gère le sens du toucher et le lobe occipital qui commande les centres de gestion de la vision. Les lobes internes regroupent le lobe limbique et le lobe central que l'on dénomme également l'insula.
Une fois planifiée, elle va être transmise au cortex moteur primaire (ou aire motrice primaire) qui va permettre l’exécution d’un mouvement adapté à la situation, en envoyant un message nerveux au muscle correspondant. Le cortex moteur primaire s’organise de la façon suivante; chaque région du cortex moteur primaire commande une partie précise du corps. La surface dans le cortex moteur primaire attribuée aux différentes parties du corps, varie en fonction de la complexité des mouvements réalisés par celles-ci. Par exemple, la bouche et notamment les lèvres ou la langue, occupent un espace plus important que le coude ou la hanche. La représentation des parties du corps en fonction de l'importance qu'occupe chaque fonction de l'organisme dans le cerveau est appelée l'homonculus.
Schéma représentant les quatre lobes du cerveau
Dessin représentant l'homonculus humain
Issus du cortex moteur primaire, les messages nerveux se dirigent vers l’organe effecteur, dans ce cas le muscle, pour effectuer le mouvement. Les axones de ces neurones descendent le long du bulbe rachidien, constituant la partie inférieure du tronc cérébral situé dans le crâne et reliant le cerveau et la moëlle épinière (ou moelle spinale). L'axone, ou fibre nerveuse, est le prolongement du neurone qui conduit le signal électrique du corps cellulaire vers les zones synaptiques. Le long de l'axone, ce signal est constitué de potentiels d'action.
Au niveau du bulbe, les axones du cortex moteur de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit se croisent (les neurones issus de l’hémisphère droit du cerveau contrôlent la partie gauche du corps et inversement, on les appelle des neurones pyramidaux) → cliquez pour avoir plus d'information sur la latéralité oeil- main croisée.
Au niveau de la moelle épinière, les axones vont se connecter aux motoneurones du muscle et le message nerveux passe du neurone au motoneurone, c’est la synapse neuro-neuronique. La synapse a lieu lors de la rencontre des deux neurones, concrètement des boutons pré-synaptique et post-synaptique, costituant l'extrémité des axones respectifs. Le premier transmet le message nerveux électrique et contient des vésicules remplies de neuro-transmetteurs pendant que le deuxième contient les récepteurs, dont la forme est complémentaire à leur neurotransmetteur.

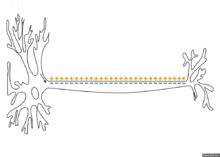
Le message nerveux életrique le long de l'axone se fait sous forme de potentiel d'action: "évènement court durant lequel le potentiel électrique d'une cellule (notamment les neurones) augmente puis chute rapidement." Durant la dépolarisation, il y a entrée d'ions Na+ par la membrane du neurone et la repolarisation consiste en la sortie d'ions K+ (on nomme hyperpolarisation une repolarisation plus longue).
Ce potentiel d'action entraine l'ouverture de canneaux calciques Ca2+, le calcium pénètre dans la cellule et entraine à son tour la migration des vésicules vers l'extrémité du bouton pré- synaptique. Les vésicules s'ouvrent alors et libèrerent des neurotransmetteurs qui se posent en face des récepteurs et s'y fixent.
Schéma animé représentant le potentiel d'action le long de l'axone
Schéma illustrant les étapes de la transmission du message nerveux au niveau synaptique
Remarque: Le long de l'axone du neurone présynaptique, le message nerveux est électrique. Au niveau de la synapse, le message nerveux et chimique puisqu'il n'y a pas de contact entre les boutons; ils sont séparés par la fente synaptique, ce qui n'empêche pas la fixation des neurotransmetteurs avec les récepteurs. Une fois le message nerveux arrivé sur la neurone postsynaptique, le premier redevient électrique et prend le relais le long du nouvel axone sous forme de potentiel d'action.
Une fois l'information reçue par le motoneurone, la synapse neuromusculaire à lieu. Elle assure la transmission du message nerveux jusqu'à la fibre musculaire concernée qui exécute à son tour le mouvement souhaité.